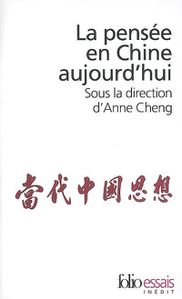C’est un fait : j’ai grandi avec Loft Story, Secret Story, et autres Star Academy. Je fais donc partie
bien malgré moi de cette première génération de la téléréalité dont les philosophes et historiens de la fin du XXIème siècle pourront évaluer sans pitié les ravages (ou les mirages)
d’une culture biberonnée par Benji et Nikos.
Alors que j’usais mes pantalons sur les bancs du collège (déjà tous remplacés par ces chaises immondes
aux couleurs incofortables), je me souviens néanmoins que la télévision était encore teintée d’un vernis de culture… ou du moins, c’est ce qu’elle prétendait nous faire
croire !
Qui n’a pas entendu un soir d’insomnie les philosophes bien-pensants débattre du néant en se donnant des
airs convenus appuyés de références stéréotypées ? Je me souviens qu’à l’époque, la mention obligatoire pour discuter de la téléréalité était celle du fameux « Big
Brother » de George Orwell. Impossible d’y échapper ! A tel point que c’est ce nom que la société Endemol a choisi pour développer son
concept initial d’émission à l’échelle internationale.
Il m’a fallu plus de dix ans pour m’extraire de cette idée pervertie par les multinationales de
l’audiovisuel…
Profitant d’une nuit d’insomnie, et à défaut de plateau télévisé, je me suis replongé dans
1984 de George Orwell. Il ne faut pas plus de quelques pages pour comprendre que les "intellectuels" invoquant cet ouvrage pour décrire et analyser les
excès de la téléréalité n’avaient probablement jamais rien lu d’autre que la notice Wikipédia pour bâtir leurs réflexions. Dans la continuité de La Ferme des Animaux,
l’écrivain britannique et ancien sympathisant trotskyste poursuit sa critique acerbe (mais efficace) du communisme soviétique.
L’utilisation de la figure de Big Brother pour analyser un concept strictement
capitaliste visant à créer des profits par la diffusion d’images d’individus a priori sans intérêt (et donc sans valeur numéraire) me paraît particulièrement inopérante, voire
contreproductive. Ce que dénonce Orwell dans 1984, c’est la constitution d’une force suffisamment puissante pour imposer la captation omniprésente et
oppressante d’images quotidiennes visant à renforcer son pouvoir. A l’inverse, la téléréalité profite d’une évolution sociétale qui conduit des individus à réprimer toute intimité et toute pudeur
pour se livrer avec indécence aux caméras.
L’ouvrage m’a en revanche beaucoup plus inspiré pour la réflexion que Georges Orwell
développe autour des notions d’histoire et de mémoire.
Le métier exercé par Winston, le personnage principal, est en effet au centre d’une réflexion sur
l’histoire, la mémoire et le pouvoir : il est chargé de réécrire quotidiennement le passé en fonction des aléas politiques. Discrètement, dans un petit bureau sans fenêtre, il reçoit des
archives qui ne répondent plus à la lecture officielle. Dès lors, il supprime quelques noms, change quelques dates ou bien invente une nouvelle Histoire visant à faire oublier la précédente.
L’archive authentique, qui peut aussi bien être une falsification antérieure devant être réactualisée, est alors détruite par l’intermédiaire d’une fente mystérieuse et judicieusement appelée
« trou de mémoire ».
Les archives ne sont cependant pas le seul prisme par lequel opère ce pouvoir totalitaire. Les rares
livres d’histoire sont également soumis à une écriture officielle, tandis que l’enseignement de l’histoire, tout comme les historiens, ont été éliminés au profit d’employés tels que Winston qui
sont de véritables techniciens bouchant les trous et rafistolant les jointures mal combinées de l’Histoire politicienne.
George Orwell précise aussi que « les statues, les inscriptions, les pierres
commémoratives, les noms de rues, tout ce qui aurait pu jeter une lumière que le passé, avait été systématiquement changé ». Ces détails réalistes démontrent à quel point il avait
développé sa réflexion sur ce monde infernal prisonnier du présentisme.
L’intrigue repose essentiellement sur la mémoire du principal protagoniste qui, impliqué dans la machine
à oublier, introduit un grain de sable en refusant de se discipliner lui-même. Se souvenir devient alors un acte de résistance solitaire, puis collectif, pour lequel il va être sévèrement châtié.
Menacé et torturé, il doit répéter devant son bureau le slogan du Parti : « Qui commande le passé commande l’avenir ; qui commande le présent commande le
passé ».
La conséquence la plus profonde de cette pratique totalitaire est l’effacement quasiment irrémédiable de
la mémoire sociale. A défaut de repères fixes et tangibles, l’esprit humain refuse progressivement toute inscription pérenne sur son disque dur. Seules les idées les plus simples sont
entretenues, à savoir l’adoration du chef protecteur et la détestation de l’ennemi criminel. Peu importe l’ennemi, peu importe ses crimes, peu importe qu’il existe… Seules comptent les pulsions
qui dirigent les hommes. Or, à défaut de pouvoir capter les failles et les contradictions du système que la mémoire ne peut retenir, les hommes sont soumis à la plus terrible des
manipulations.
Les conclusions de l’auteur sont alors sans appel sur cette situation « La mémoire était
défaillante et les documents falsifiés, la prétention du Parti à avoir amélioré les conditions de la vie humaine devait alors être acceptée, car il n’existait pas et ne pourrait jamais exister de
modèle à quoi comparer les conditions actuelles ».
Outre la qualité littéraire de ce roman, il convient sur ce blog de s’interroger sur son enseignement en
2011 à la lueur d’un monde nouveau qu’Orwell avait anticipé. Certains extraits peuvent alors être lus avec une provocation anachronique qui, toute proportion gardée, ne manquera pas néanmoins de
faire réfléchir sur une éventuelle théorisation du contrôle des masses par l'intermédiaire d'un contrôle du passé :
1. « Le changement du passé est nécessaire pour deux raisons dont l’une est subsidiaire et,
pour ainsi dire, préventive. Le membre du Parti, comme le prolétaire, tolère les conditions présentes en partie parce qu’il n’a pas de terme de comparaison. Il doit être coupé du passé,
exactement comme il doit être coupé d’avec les pays étrangers car il est nécessaire qu’il croie vivre dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles vivaient ses ancêtres et qu’il
pense que le niveau moyen de confort matériel s’élève constamment ».
=> Depuis quelques mois, le gouvernement français a décidé que les élèves de lycée n’apprendront plus
l’histoire contemporaine après 1962…
=> Malgré la diffusion des technologies d’information et de communication, plusieurs études montrent
que ces réseaux renforcent plus les frontières linguistiques qu’ils ne les dépassent. D’ailleurs, à l’instar de la Chine, les pays occidentaux réfléchissent actuellement à un « Internet
civilisé » et mieux contrôlé par les forces politiques.
2. « Mais la plus importante raison qu’a le Parti de rajuster le passé est, de loin, la
nécessité de sauvegarder son infaillibilité. Ce n’est pas seulement pour montrer que les prédictions du Parti sont dans tous les cas exactes, que les discours statistiques et rapports de toutes
sortes doivent être constamment remaniés selon les besoins du jour. C’est aussi que le Parti ne peut admettre un changement de doctrine ou de ligne politique. Changer de décision, ou même de
politique est un aveu de faiblesse ».
=> Jouons un peu : je vous mets au défi de retrouver sur le site Internet de l’Elysée des traces
de la réception de Mouammar Kadhafi en France en 2007.
3. « La mutualité du passé est le principe de base de l’Angsoc. Les évènements passés,
prétend-on, n’ont pas d’existence objective et ne survivent que par les documents et la mémoire des hommes. Mais comme le Parti a le contrôle complet de tous les documents et de l’esprit de ses
membres, il s’ensuit que le passé est ce que le Parti veut qu’il soit. Il s’ensuit aussi que le passé, bien que plastique, n’a jamais, en aucune circonstance particulière, été changé. Car
lorsqu’il a été recréé dans la forme exigée par le moment, cette nouvelle version, quelle qu’elle soit, est alors le passé et aucun passé différent ne peut avoir jamais existé. Cela est encore
vrai même lorsque, comme il arrive souvent, un évènement devient méconnaissable pour avoir été modifié plusieurs fois au cours d’une année. Le Parti est, à tous les instants, en possession de la
vérité absolue, et l’absolue ne peut avoir jamais été différent de ce qu’il est ».
=> Outre de multiples pressions financières et institutionnelles, l’écriture de l’histoire est
aujourd’hui conditionnée par des lois mémorielles issues des instances politiques. Cette fois-ci, la réalité dépasse la fiction que George Orwell aurait pu
imaginer.
4. « Plus tard, au XXe siècle, il y eut les totalitaires, comme on les appelait. C’était les
nazis germains et les communistes russes. Les Russes persécutèrent l’hérésie plus cruellement que ne l’avait fait l’Inquisition, et ils crurent que les fautes du passé les avaient instruits. Ils
savaient, en tout cas, que l’on ne doit pas faire des martyrs. Avant d’exposer les victimes dans des procès publics, ils détruisaient délibérément leur dignité. Ils les aplatissaient pas la
torture et la solitude jusqu’à ce qu’ils fussent des êtres misérables, rampants et méprisables, qui confessaient tout ce qu’on leur mettait à la bouche, qui se couvraient eux-mêmes d’injures, se
mettaient à couvert en s’accusant mutuellement, demandaient grâce en pleurnichant. Cependant, après quelques années seulement, on vit se répéter les mêmes effets. Les morts étaient devenus des
martyrs et leur dégradation était oubliée. Cette fois encore, pourquoi ? En premier lieu, parce que les confessions étaient évidemment extorquées et fausses. Nous ne commettons pas d’erreurs
de cette sorte. Toutes les confessions faites ici sont exactes. Nous les rendons exactes et, surtout, nous ne permettons pas aux morts de se lever contre nous. Vous devez cesser de vous imaginer
que la postérité vous vengera, Winston. La postérité n’entendra jamais parler de vous. Vous serez gazéifié et versé dans la stratosphère. Rien ne restera de vous, pas un nom sur un registre, pas
un souvenir dans un cerveau vivant. Vous serez annihilé, dans le passé comme dans le futur. Vous n'aurez jamais existé ».
=> A défaut de pouvoir éliminer le souvenir de son existence (qui a été fort utile jusqu'à présent), les autorités américaines ont fait disparaître le corps de
l’ennemi public numéro 1 : Ben Laden. Depuis, le monde assiste à une immense campagne de discréditation par la diffusion d'informations superficielles sur l’addiction au
coca-cola, les teintures, ou encore les difficultés d’allocution du terroriste.
Pour conclure sur ces extraits à méditer, il n’est bien entendu pas question d’affirmer ici que notre
monde serait plus totalitaire que celui imaginé par Orwell, mais plutôt de rappeler qu’aucun monde ne sera jamais à l’abri d’une dérive autoritaire et qu’il est parfois sain de
s’indigner avant que cette liberté ne disparaisse.


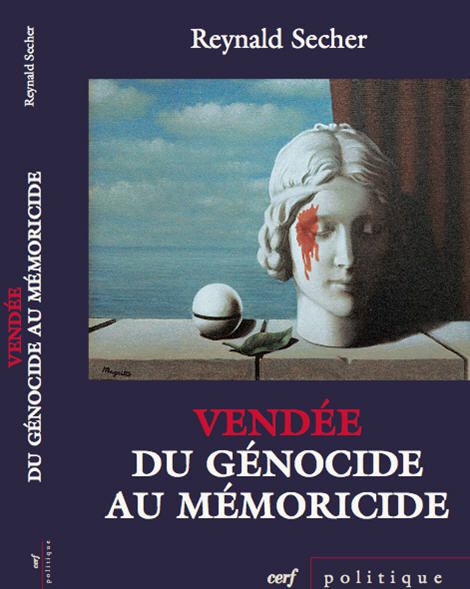













 Portrait d'Ernest Laviss
Portrait d'Ernest Laviss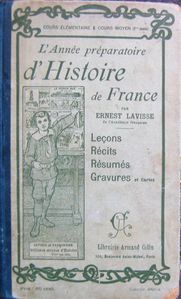
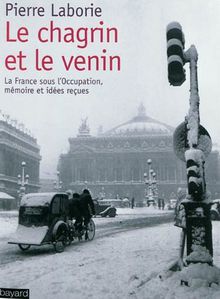
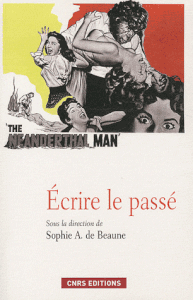
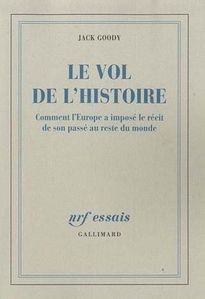 Jack GOODY, Le vol de l'histoire
Jack GOODY, Le vol de l'histoire